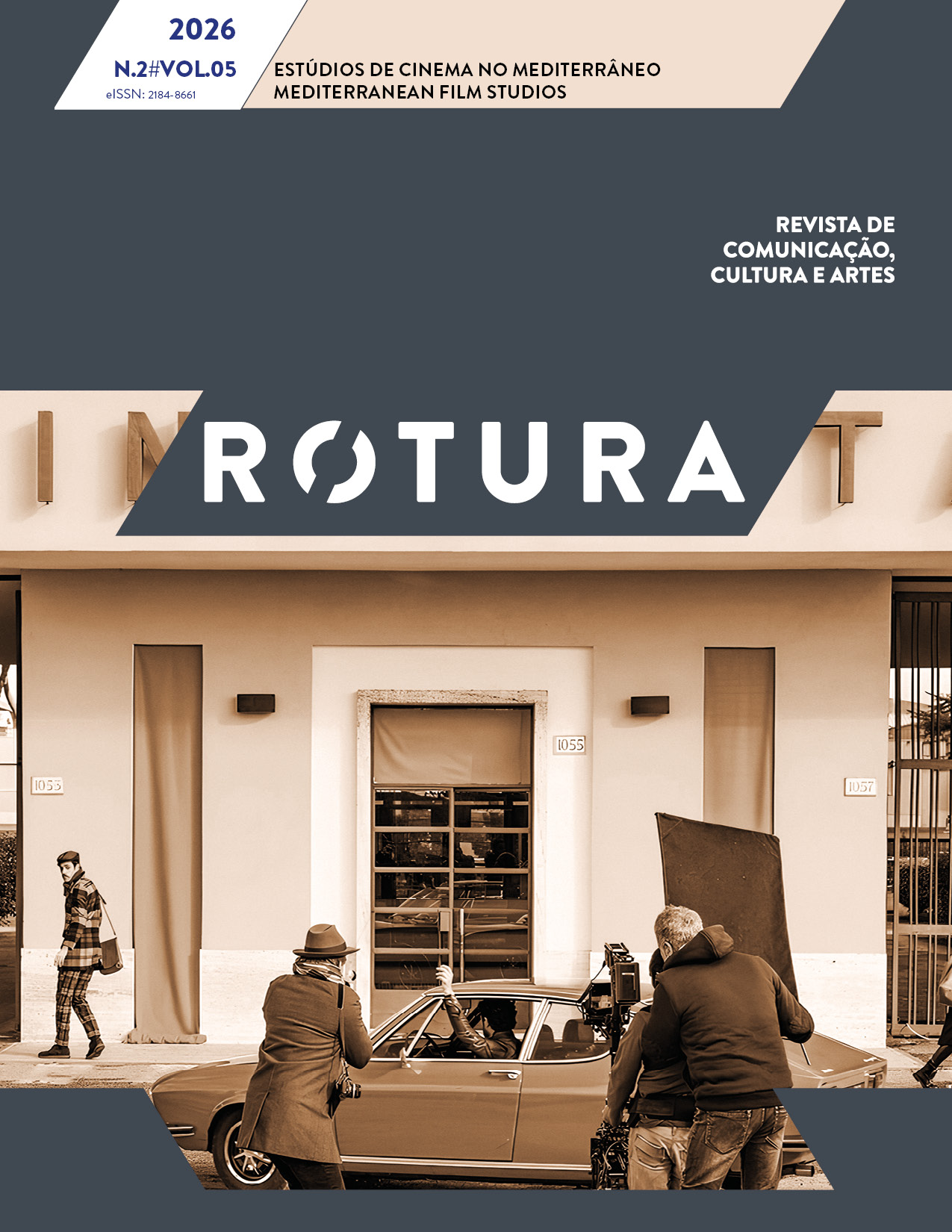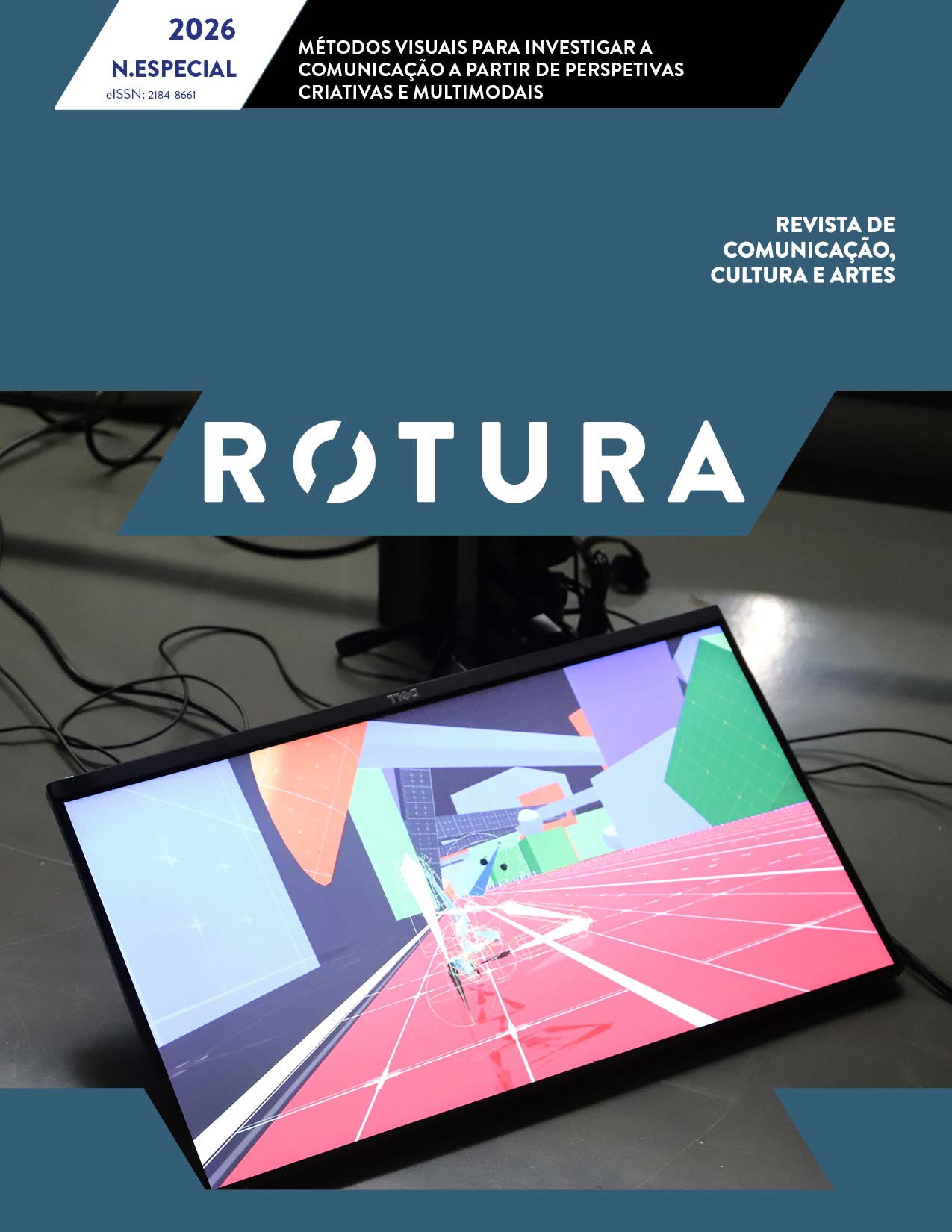Appel à Contributions
Studios Cinématographiques Méditerranéens
Les studios de cinéma ont joué un rôle central dans l’histoire de la production audiovisuelle depuis le début du XXe siècle, des premières serres en verre aux vastes complexes hollywoodiens et ailleurs. Les studios dégagent une impression de glamour et de mystère, ce qui en a fait des attractions touristiques. Pourtant, dans les études cinématographiques, l’attention s’est surtout portée sur l’interprétation des films, la trajectoire des réalisateurs, producteurs, stars, ou sur l’étude des publics et des lieux de projection. Dans les études où les studios apparaissent, ils sont souvent amalgamés à l’histoire des sociétés de production, considérés comme des outils nécessaires pour atteindre des objectifs financiers, plutôt que comme des lieux spécifiques dignes d’étude en eux-mêmes.
Les studios sont des laboratoires d’innovation et de créativité. Ce sont des structures physiques qui reflètent leur fonction, mais qui médiatisent aussi des tendances architecturales et culturelles plus larges. Ce sont des environnements de travail structurés autour de conventions, règles, politiques et pratiques collaboratives spécifiques, et ils peuvent être vus comme des microcosmes de développements sociaux et politiques plus larges. Cette nature multifacette des studios de cinéma a récemment commencé à être redécouverte par les chercheurs, notamment dans les travaux de Brian Jacobson (2015 et 2020) et Street et al (2026).
Alors que l’histoire des grands studios hollywoodiens est relativement bien documentée, il existe, à quelques exceptions près (par exemple García de Dueñas et Gorostiza, 2001 ; Street 2024), relativement peu de travaux sur les studios ailleurs. Street et al ont cartographié l’histoire des studios en Grande-Bretagne, France, Allemagne et Italie depuis le début du cinéma sonore jusqu’à la fin des années 1950, tout en soulignant l’interaction et la circulation transnationale entre ces pays. L’anthologie de Jacobson propose une gamme plus large d’études de cas et de périodes, mais dans leur focalisation distincte, elles manquent de contextes et d’interactions transnationales plus larges.
Reconnaissant la nécessité de reconsidérer les connexions et réseaux régionaux et transnationaux, cet appel à contributions s’appuie sur ces interventions et invite des travaux qui explorent l’histoire des studios de cinéma dans l’espace méditerranéen (Europe du Sud, Afrique du Nord, Levant), des débuts du cinéma à aujourd’hui, et leurs relations entre eux. Nous sommes particulièrement intéressés par les sujets suivants :
- Histoires de studios individuels
- Studios comme symboles de la culture nationale
- Relations transnationales entre studios
- Architecture et design des studios
- Destinées des studios comme patrimoine, attractions touristiques ou biens immobiliers
- Pratiques de travail
- Évolutions technologiques
Bibliographie :
García de Dueñas, J., & Gorostiza, J. (2001). Los estudios cinematográficos españoles. Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas.
Jacobson, B. R. (2015). Studios before the system: Architecture, technology, and the emergence of cinematic space. Columbia University Press.
Jacobson, B. R. (Ed.). (2020). In the studio: Visual creation and its material environments. University of California Press.
Street, S. (2024). Pinewood: Anatomy of a film studio in post-war Britain. Springer.
Street, S., et al. (2026). Film studios in Britain, France, Germany and Italy: Architecture, innovation, labour, politics, 1930–60 (forthcoming). Bloomsbury.
Tim Bergfelder est professeur d’études cinématographiques à l’Université de Southampton (Royaume-Uni). Il est coéditeur de la revue Screen, éditeur de la série Film Europa chez Berghahn et de la série Palgrave European Film and Media Studies. Il est coauteur du livre à paraître Film Studios in Britain, France, Germany and Italy. Architecture, Innovation, Labour, Politics, 1930–1960 ; Londres : BFI/Bloomsbury (2026). Ses précédentes publications en tant qu’auteur, éditeur et coéditeur incluent « EXIL SHANGHAI as Audio-Visual Archive and Cross-Cultural Collage. » In : Angela McRobbie (éd.), Ulrike Ottinger. Film, Art and the Ethnographic Imagination (Bristol : Intellect, 2024) ; The German Cinema Book (deuxième édition, Londres ; BFI, 2020) ; « Popular European Cinema in the 2000s : Cinephilia, Genre and Heritage, » in Mary Harrod, Mariana Liz, and Alissa Timoshkina (éds.), The Europeanness of European Cinema. Identity, Meaning, Globalization, Londres et New York : I.B. Tauris, 2015 ; Destination London : German-speaking émigrés and British Cinema, 1925–1950 (Oxford et New York : Berghahn, 2008) ; Film Architecture and the Transnational Imagination : Set Design in 1930s European Cinema (Amsterdam : Amsterdam University Press, 2007) ; International Adventures. Popular German Cinema and European Co-Productions in the 1960s (Oxford et New York : Berghahn, 2005).
- https://orcid.org/0000-0001-6585-6123
- https://www.southampton.ac.uk/people/5wyk6m/professor-tim-bergfelder
Jorge Manuel Neves Carrega est membre titulaire du CIAC – Centre de Recherche en Arts et Communication de l’Université de l’Algarve, où il enseigne des cours de cinéma, arts et communication depuis 2012. Il coordonne actuellement le Groupe de Travail Études Cinématographiques du CIAC et organise le Colloque Cinémas Méditerranéens. Il est également vice-président de l’AIM – Association des Chercheurs de l’Image en Mouvement. Il mène actuellement des recherches sur l’histoire de l’exposition cinématographique en Algarve et coordonne le projet CURATE, qui étudie la collection d’affiches du Musée Municipal de Faro.
Jorge Carrega est l’auteur de sept livres, dont « Géneros Populares e Cinema Transnacional na Europa Mediterrânea » (CIAC, 2023), « Elvis Presley e a Cultura Popular do séc. XX » (CIAC, 2023) et « Brief Cultural History of Faro » (UFF, 2018). Il a publié une cinquantaine d’articles et de chapitres dans diverses publications académiques.
- https://orcid.org/0000-0002-0797-8891
- https://www.cienciavitae.pt//1C18-48AC-ECE7
Date limite de soumission des articles: 15-04-2026
Notification d'acceptation: 30-06-2026
Soumission de la version finale: 10-09-2026
Publication: 30-09-2026
Méthodes visuelles pour la recherche en communication selon des perspectives créatives et multimodales
Les méthodes visuelles offrent une autre façon d’explorer la réalité à partir d’une perspective visuelle médiée, visant à transcender les frontières et les spécificités disciplinaires qui limitent souvent le potentiel créatif des sciences sociales. Il y a un consensus général pour considérer les méthodes visuelles comme celles qui intègrent la création visuelle dans le processus de recherche, bien que leur champ d’application aille au-delà. Les pratiques médiatiques multimodales, les approches sensorielles et les méthodes participatives ou collaboratives façonnent ce domaine flexible et en constante évolution, qui se caractérise par sa capacité à donner du sens aux représentations et créations audiovisuelles au sein même du processus de recherche (Pink, 2009 ; Bouldoires et al., 2017 ; Yvart et al., 2023). Ce mouvement se distingue par son caractère indépendant, interdisciplinaire, voire « un-disciplinaire ». Les relations corporelles et subjectives (Ruby, 2000 ; MacDougall, 1995) qui façonnent l’expérience visuelle et construisent la représentation illustrent les ambitions multiples de ces méthodes, qui nécessitent une réflexion plus approfondie sur les données qu’elles génèrent – un aspect qui n’est pas toujours suffisamment pris en compte (Buckingham, 2009 ; Switzer, 2018). Des approches telles que celles de Cruz, Sumartojo et Pink (2017) et d’Ibanez-Bueno et Marín (2021) se concentrent sur les nouveaux processus, les outils numériques et les formes émergentes d’écriture scientifique pour explorer leur potentiel. Ces propositions permettent de conceptualiser des formes intégrées de production et de présentation des connaissances, telles que les webdocumentaires, les récits transmédias ou les environnements immersifs à 360º, qui élargissent les modes traditionnels de communication des résultats de la recherche.
La création visuelle en tant qu’outil méthodologique n’implique pas que l’objet d’étude soit un objet ou un phénomène visuel ; cependant, en tant que méthode et approche, elle est inévitablement liée aux études sur la visualité (Contreras & Marín, 2022) et à la pratique de la communication. Les images peuvent jouer de multiples rôles dans les processus de recherche et être intégrées de diverses manières : elles peuvent être produites par les participants, créées avec des objectifs expérimentaux, trouvées et utilisées comme données empiriques ou comme artefacts évocateurs. Elles peuvent être théorisées, utilisées pour générer de nouvelles données, pour documenter des processus ou pour explorer des représentations et des interprétations subjectives et partagées. L’ambition intégrative des méthodes visuelles interroge l’éthique, la visualité, le regard, le rôle et la corporalité du chercheur, ainsi que les modes de création et de partage des connaissances.
SUJETS POSSIBLES
Nous vous invitons à soumettre des articles empiriques et théoriques qui réfléchissent aux méthodes de recherche visuelle.
- Méthodologies visuelles et technologies émergentes
- Vision et intelligence artificielle dans les recherches en méthodes visuelles
- Intersections entre les méthodes visuelles et les pratiques de recherche-création
- Études critiques sur l’éthique interprétative dans les processus de recherche visuelle
- Création scientifique visuelle et esthétique : post-documentaire, immersive, interactive ou transmédia
- Cas et restitutions visuelles numériques dans la recherche
- Épistémologie et études sur la visualité algorithmique
- Analyse des politiques visuelles algorithmiques dans la reconnaissance des régimes scopiques
DATES CLÉS
Date limite de soumission des propositions: 27 février 2026
Notification d'acceptation: 30 avril 2026
Soumission de la version finale: 29 mai 2026
Publication: 30 juillet 2026
Éditeurs invités
Alba Marín Carrillo, Universidad de Extremadura (España)
albamarin@unex.es
https://scholar.google.es/citations?user=M-WRiv8AAAAJ&hl=es
https://orcid.org/0000-0003-0285-7086
Charles-Alexandre Delestage. Université Bordeaux Montaigne (Francia)
charles-alexandre.delestage@u-bordeaux-montaigne.fr
https://scholar.google.es/citations?user=UCkwGAUAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://orcid.org/0000-0002-7842-049X
Fernando Contreras Medina. Universidad de Sevilla (España)
fmedina@ues.es
https://scholar.google.es/citations?user=HtUZNuYAAAAJ&hl=es
https://orcid.org/0000-0003-1105-5800
Ricardo Ignacio Prado Hurtado. Universidad Anáhuac (México)
r.prado@anahuac.mx
https://scholar.google.es/citations?user=WPoUKnEAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://orcid.org/0000-0002-4502-428X
Alba Marín. Professeur PAD à l’Université d’Extremadura, au Département d’Information et de Communication (Espagne). Elle a été chercheuse postdoctorale à l’Université de Séville (NextGenerationEU) et ATER au département de communication hypermédia de l’Université Savoie Mont Blanc. Elle est titulaire d’un doctorat international en communication de l’Université Grenoble Alpes / USMB et de l’Université de Séville. Maître de Conférences en Sciences de l’Information et de la Communication (71e section) et membre des laboratoires SEJ003 : AR-CO (communication) et HUM868 : Études visuelles, art et patrimoine culturel. Son travail explore la signification sociale de l’image, l’activisme médiatique et le documentaire social dans le cadre des études visuelles et des méthodes visuelles.
Charles Alexandre Delestage. Maitre de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université Bordeaux Montaigne rattaché au laboratoire MICA, et chercheur associé au laboratoire ELLIADD de l’Université de Franche-Comté. Il est spécialisé sur l’expérience émotionnelle de l’individu en réception de contenus culturels, avec un focus sur la production et la réception de contenus faisant appel aux technologies immersives. Il est également trésorier de la société savante Visual Modi, association internationale de recherche sur les méthodes visuelles et multimodales. Il développe depuis 10 ans l’outil Spot Your Mood avec Willy Yvart, qui vise à l’aide à la verbalisation et à la représentation visuelle des émotions.
Fernando Contreras Medina. Professeur des Universités au département de Journalisme I de l’Université de Séville, où il enseigne la Cyberculture, le Design et les Etudes Visuelles. Il est l’auteur de El cibermundo. Dialéctica del discurso informático (1998), l’une des premières études sur la narration dans les jeux vidéos en Espagne. Il a publié récemment Estudios Visuales en Brasil (2022), El arte en la cibercultura. Introducción a una estética comunicacional (2018), et La desobediencia visual. Estética de los movimientos sociales del siglo XXI (2021).
Ricardo Ignacio Prado Hurtado. Professeur et chercheur, ainsi que coordinateur du programme d’études supérieures au Centre de recherche en communication appliquée (CICA) de l’Universidad Anáhuac México. Directeur exécutif de Mostrotown Publicidad. Il est titulaire d’un doctorat en recherche en communication de l’Universidad Anáhuac México et d’un doctorat en sciences de l’information et de la communication de l’Université Savoie Mont Blanc, où il est également chercheur associé au laboratoire LLSETI. Ses travaux portent sur les méthodes de recherche émergentes (ERM), les études sur la publicité et le contre-marketing, ainsi que sur l’alimentation et la communication pour la santé nutritionnelle.
Bibliographie
Bouldoires, A., Reix, F. y Meyer, M. (2017). Méthodes visuelles : définition et enjeux. Revue Française des Méthodes Visuelles, no 1 (juillet). https://rfmv.fr/numeros/1/introduction/.
Ibanez-Bueno, J., y Marín, A. (2021). Images interactives et nouvelles écritures. Un mouvement émergent pour de nouvelles écritures interactives. Revue française des méthodes visuelles, (5). https://doi.org/10.4000/12mp0
Buckingham, D. (2009). `Creative’ Visual Methods in Media Research: Possibilities, Problems and Proposals. Media, Culture & Society, 31(4): 633-52. https://doi.org/10.1177/0163443709335280.
Contreras, F.R. y Marín, A. (2022). Estudios Visuales en Brasil. Tirant lo Blanc.
Cruz, E. G., Sumartojo, S. y Pink, S. (2017). Refiguring Techniques in Digital Visual Research. Springer.
McDougall, D. (1995). Beyond observational cinema. In P. Hockings (ed.), Principles of Visual Anthropology. Mouton de Gruyter.
Pauwels, L. (2010). Taking the visual turn in research and scholarly communication key issues in developing a more visually literate (social) science. Visual Sociology, 15(1): 7-14. https://doi.org/10.1080/14725860008583812.
Pink, S. (2009). Doing Sensory Ethnography. Sage.
Ruby, J (2000). Picturing culture: explorations of film and anthropology. The University of Chicago Press.
Switzer, S. (2018). «That’s in an Image?: Towards a Critical and Interdisciplinary Reading of Participatory Visual Methods». En Moshoula Capous-Desyllas y Karen Morgaine (Eds.), Creating Social Change Through Creativity, pp. 189-207. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52129-9_11.
Yvart, W., Delestage, C.A. y Lamboux-Durand, A. (2023). Les contours des méthodes visuelles. In III Conference on Visual and Multimodal Methods, Universidad de La Laguna, Tenerife, Espagne.
Artivisme numérique – Intersections de l’art, de l’activisme et de la transformation sociale
À l’ère de la saturation numérique, de la connectivité omniprésente, du contrôle algorithmique et des flux d’information mondiaux, l’artivisme numérique s’impose comme une forme puissante de résistance créative. Il opère à l’intersection de l’innovation artistique et de l’intervention politique, utilisant outils, plateformes et esthétiques numériques pour remettre en question les récits dominants, dénoncer les injustices et mobiliser les communautés en faveur d’une transformation sociale. L’expansion rapide des réseaux sociaux et du partage numérique a remodelé les contours de l’activisme. De l’immédiateté des mèmes viraux qui tournent en dérision les dirigeants politiques à la prolifération de la publicité subvertie — détournement de la publicité d’entreprise pour révéler ses idéologies sous-jacentes —, l’activisme numérique se nourrit du remix, de la visibilité et de la perturbation. Les activistes ont conçu des campagnes en GIF, de l’art interactif en ligne, des contre-récits générés par IA, et des interventions en réalité augmentée qui interrogent l’espace public, les politiques identitaires et de classe, l’urgence climatique ou la culture de la surveillance. Des formes plus radicales — et souvent illégales — telles que l’hacktivisme, défient les institutions à travers des actions numériques directes, allant de la défiguration de sites web et de la fuite de données à la perturbation tactique d’infrastructures étatiques et corporatives. Des projets tels que les opérations en ligne d’Anonymous, les actions provocatrices du groupe The Yes Men ou les piratages artistiques à teneur politique de collectifs comme !Mediengruppe Bitnik illustrent la manière dont les outils numériques peuvent devenir des armes à la fois esthétiques et politiques pour exiger transparence et responsabilité. L’artivisme numérique se manifeste également dans les pratiques génératives qui mobilisent des systèmes algorithmiques pour critiquer les biais des données, dans les collectifs artistiques en ligne qui créent des plateformes de protestation anonyme, ou dans les performances en réalité étendue (XR) qui réimaginent l’histoire et les futurs possibles de la résistance. Ce qui relie ces formes diverses, c’est leur capacité à provoquer une réflexion critique tout en engageant les publics à travers la culture visuelle, la littératie numérique et la participation en réseau. L’artivisme numérique n’est pas seulement une méthode d’intervention, mais aussi un vecteur de récit, de construction communautaire et d’imagination d’alternatives.
Nous invitons des contributions abordant les dimensions théoriques, historiques, méthodologiques et pratiques de l’artivisme numérique, en particulier celles qui interrogent son potentiel de transformation dans les sociétés médiatiques contemporaines. Divers formats de travaux inédits sont acceptés : articles de recherche, réflexions issues de la pratique, études de cas, analyses interdisciplinaires. Les contributions doivent proposer des perspectives originales sur le potentiel transformatif des pratiques numériques créatives à l’intersection de l’art et de l’activisme. Thèmes possibles (liste non exhaustive) :
- Histoires et généalogies de l’artivisme numérique
Contributions contextualisant les origines, trajectoires et évolutions de l’artivisme numérique dans des récits plus larges de résistance politique, d’innovation artistique et de développement technologique.
- Cadres théoriques et conceptuels
Approches critiques sur les pratiques d’appropriation, le remix, la subversion, le culture-jamming, l’hacktivisme, les médias tactiques, et d’autres formes d’intervention hybride activiste-artistique.
- Pédagogies critiques et formes inclusives d’art numérique
Analyses des pratiques artivistes dans les contextes éducatifs, centrées sur l’esthétique relationnelle, l’art socialement transformateur, et les pratiques artistiques numériques interventionnelles.
- Artivisme numérique et co-construction communautaire
Études sur la façon dont l’artivisme numérique participe à la (co)(re)construction des identités minoritaires, en réponse à la marginalisation sociale, politique ou culturelle.
- Artivisme numérique et Agenda 2030 de l’ONU pour le développement durable
Réflexions sur l’apport de l’artivisme numérique aux Objectifs de développement durable (ODD), en lien avec la justice environnementale, l’action climatique et les écosystèmes durables.
- Méthodologies de la pratique et de la participation
Contributions sur les méthodologies participatives et co-créatives dans les pratiques artivistes. Études de cas et recherches basées sur la pratique bienvenues.
- Entre art politique et art activiste
Réflexions critiques sur les distinctions entre art politique et art activiste, leurs objectifs, publics, modalités d’intervention et impacts sociopolitiques.
Dates importantes :
Date limite de soumission : 30 septembre 2025
Notification d’acceptation : 15 novembre 2025
Soumission de la version finale : 31 décembre 2025
Publication : 1er février 2026
Éditeurs : Isabel Cristina Carvalho (CIAC, Universidade Aberta), Marc Garrett (Furtherfield, Ravensbourne College of Design and Communication) et Pedro Alves da Veiga (CIAC, Universidade Aberta).
Isabel Carvalho est une artiste et chercheuse, formée en architecture et titulaire d’un doctorat en art des médias numériques (2016), centré sur les médias locatifs et les flux urbains. Elle a été chercheuse postdoctorale en animation informatique à l’Université de Bournemouth (2018–2019). Actuellement, elle est chercheuse au CIAC, Universidade Aberta, où elle étudie les processus de cartographie communautaire et collaborative, ainsi que l’interaction entre les personnes, les espaces et la technologie, en mettant l’accent sur l’hybridation entre réel et virtuel dans les expériences urbaines à travers l’art des médias locatifs.
Marc Garrett est artiste, écrivain, activiste et commissaire. Il a cofondé, avec Ruth Catlow, le collectif d’art Internet Furtherfield en 1996, et codirige sa galerie et son laboratoire à Finsbury Park, Londres, depuis 2004. Il a cocommandité de nombreuses expositions et publications d’art médiatique, notamment Artists Re:Thinking the Blockchain (2017) et Frankenstein Reanimated (2022). Sa biographie biopolitique Feral Class paraîtra à l’été 2025, suivie de 30 Years of Furtherfield (automne 2025), coéditée avec Regine DeBatty et Martin Zellinger.
Pedro Alves da Veiga est actuellement professeur et directeur adjoint du programme de doctorat en art des médias numériques à l’Université Aberta, au Portugal. Ses recherches articulent les domaines de l’art, de la science, de la technologie et de la société, avec un accent sur l’impact des économies de l’attention et de l’expérience sur les écosystèmes de l’art des nouveaux médias, la conservation des médias numériques et les méthodologies de recherche fondées sur la pratique artistique. En tant qu’artiviste, Veiga explore l’art génératif, les systèmes interactifs, la programmation créative, l’assemblage et l’audiovisuel numérique.
Appel à contributions (permanent)
- VVaria (articles autres que ceux du dossier);
- Critiques et interviews;
- Chronique d'Art.